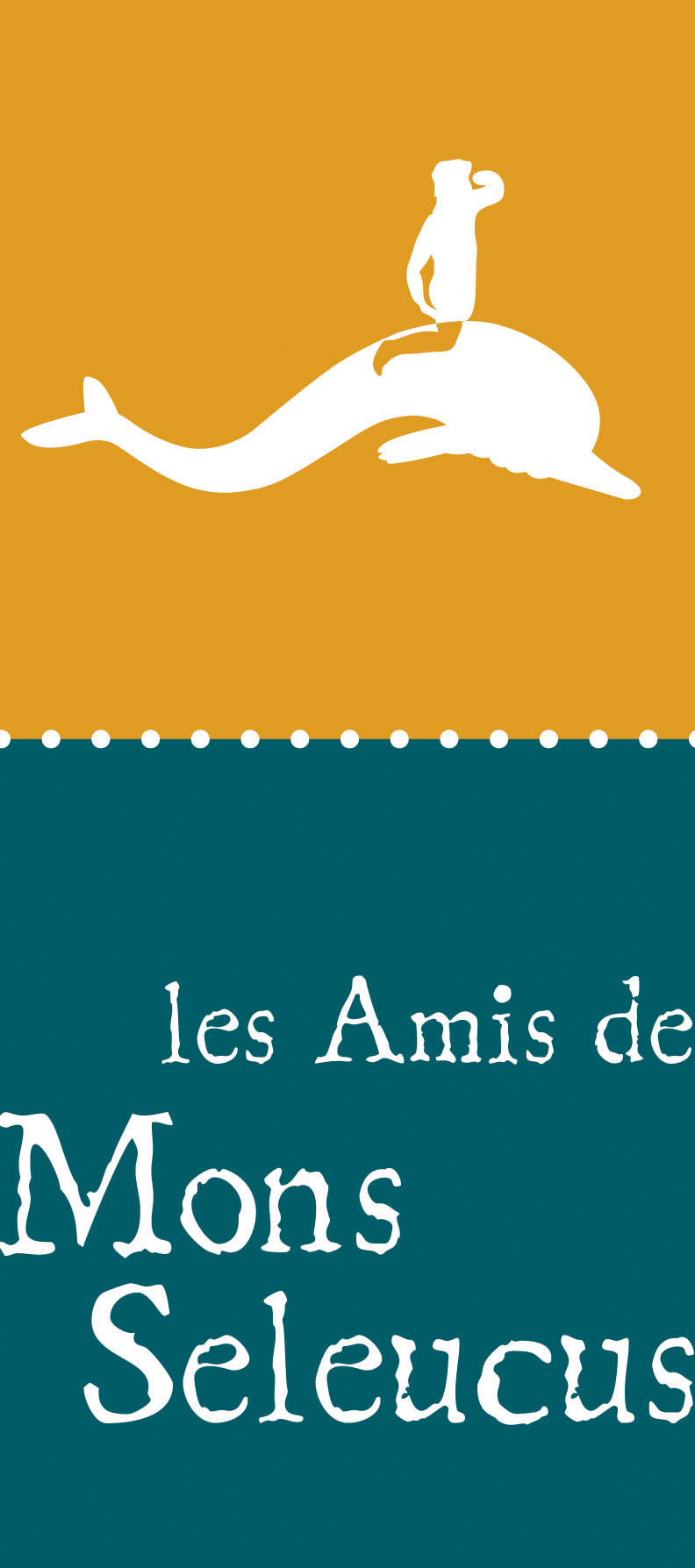|
|
|
Histoire du
site de Mons Seleucus
haut
Un
site exceptionnel
La
grande
Bataille de Mons Seleucus
Les
fouilles de 1800 à 1805
Les
fouilles de 1836 et 1837
Les
découvertes fortuites du XIXe siècle
Les
fouilles de 1972
Photographies
aériennes 1991 - 2000
Mission Valorisation du
patrimoine
La
diffusion des connaissances auprès du
public
La Narbonnaise
Prospections
géophysiques
Fouilles 2005
Mons Seleucus, un
site exceptionnel, mais sous terre
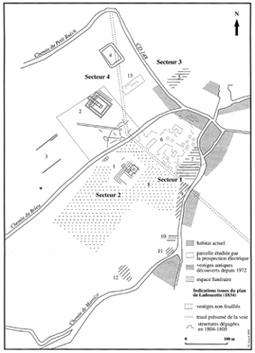
Le site gallo-romain de la plaine de
Lachau est connu depuis le XVIIIème
siècle. Les premières découvertes
répertoriées ont lieu lors de travaux
des champs ou de glissements de terrain
: structures de bâtiments sur la plaine
de Lachau, statuettes, monnaies, lampes,
mosaïques et céramiques, envoyées
généralement à Grenoble et conservées au
Musée Dauphinois. Le seul objet
découvert à cette époque identifiable
avec certitude est un index appartenant
à une statue monumentale. Les autres
objets (des bronzes, céramiques
diverses, mosaïques, etc.) ont été
égarés.
Témoignage de Pierre Antoine Farnaud,
secrétaire général de la préfecture des
Hautes-Alpes de 1800 à 1834, sur
quelques circonstances de ces
découvertes :
“ M. Bertrand (...) devenu depuis
procureur du Roi près le tribunal de Gap
en a été le principal auteur. C'était à
la fin du XVIIIe siècle, se trouvant
dans la chambre de son fermier, il
aperçut sur la cheminée une petite louve
de bronze, dont la pose, le regard et le
disque représentant une tête qu'elle
portait à la patte gauche de devant, lui
firent comprendre, au moyen de la
fracture qu'elle laissait apercevoir à
la naissance, qu'elle devait avoir fait
partie d'un groupe.
Il apporta (...) une statuette en
bronze, représentant Mercure, la tête
levée et couverte d'un chapeau ailé
(...). Le dieu était couvert d'un
manteau et tenait une boule dans la main
gauche. Tout annonçait qu'il portait un
caducée de la droite. Il était chaussé
d'un brodequin.
[ Les intendants de la province avaient
déjà reçu ] pour être déposés au musée
des antiques de Grenoble, plusieurs
objets intéressants, recueillis dans la
plaine de La Bâtie-Montsaléon, tels que
deux statues de Jupiter, un Mercure, une
Diane, plusieurs Priape, un soldat
gaulois et un index colossal d'une
statue de bronze qui devait avoir au
moins trois mètres de hauteur.
Ces découvertes comprenaient aussi un
certain nombre de médailles. ”
La grande Bataille
de Mons Seleucus
Charles Romieu
« Les écrits de l’empereur Julien
(et de Socrate le Scholastique (380-440)
et Sozomène), font mention d’une
bataille livrée à Mons Seleucus le 11
août 353 entre l'Empereur Constance et
l'usurpateur Magnence. ».
Abbé Allemand
« …Magnence, d’après les historiens,
arrive, par la voie de Sisteron, le
premier à Mons Seleucus, et il l’occupe
ainsi que tous les cols des environs.
Magnence était un militaire de valeur
qui avait, maintes fois payé de sa
personne…. Il se hasarde donc à défendre
la vallée du Rhône et à soutenir dans ce
but, la lutte décisive …. Les généraux
de Constance arrivent à leur tour par le
Mont-Genèvre et par Gap, et ils ouvrent
l’action... »
Curé Charton 1853
« Battu en Pannonie par les généraux de
Constance, Magnence le fut de nouveau et
définitivement à Mons Seleucus le 11
août 353. On montre encore le lieu où
eut lieu la bataille, dénommé encore
aujourd'hui Champ Batailler, ainsi que
le Champ des Grâces en souvenir du lieu
où fut accordé le pardon aux vaincus.
»
Préfet Ladoucette
« …L’an 353 de l’ère chrétienne,
le 10 ou le 11 août, l’usurpateur
Magnence fut vaincu par les lieutenants
de Constance, au sud-est de la plaine de
Mons Seleucus, sur les bords du torrent
de Malaise… »
Gillet
« Une interprétation des noms de lieux
témoignent aujourd'hui encore de ce
combat meurtrier (certains ont pensé que
cette interprétation était fausse, et
que cette bataille historique aurait eu
lieu vers la Beaumette .
… la bataille de Mons Seleucus a eu lieu
certainement en plusieurs points entre
Buëch et Maraize, à Champcrose, à
Beaumette, au champ Batailler.… »
Héricart de Thurie
« …Un champ, probablement celui sur
lequel il se donna (le combat) porte le
nom de Champ Batailler. Près de là un
autre est dit les Campi Puri (Champs
Puri), un pardon général y fut accordé
aux troupes de Magnence qui, rentrant
dans leur devoir firent oublier leur
rébellion en jurant fidélité à
l’Empereur. Au dessous est le champ des
Grâces où un autel fut élevé pour
adresser aux immortels, des prières et
des actions de grâce en reconnaissance
de la victoire qu’ils avaient accordée à
Constance. A peu de distance enfin, est
le champ de l'Impereiris qui reçut ce
nom du lieu où était campée l'armée des
généraux de l’Empereur, Campus
Imperatoris »…
Abbé Allemand
« …Magnence, son armée ayant été taillée
en pièce, prit de nouveau la fuite, et,
passant par Die, parvint à Lyon, où il
égorgea sa mère et son frère, et se
donna lui-même la mort. »
L’abbé Gaillaud, ancien curé de Serres,
cite l’empereur Julien et le grec
Sozomène et raconte :
« Voyez-vous ces phalanges
composées de gaulois, de Francs, de
saxons qui franchissant la Provence,
remontent le Buëch, campent à Mons
Seleucus : cette armée est celle de
Magnence. Mais du sommet des Alpes
cottiennes, des légions intrépides
traversent le Mont-genèvre : un bruit
d’armes, de chars et de chevaux s’entend
depuis Briançon : l’antique Embrun
s’émeut ; les chants guerriers se font
entendre : les routes sont remplies de
fantassins et de cavaliers portant des
faisceaux d’armes, de lances de javelots
; les archets, les frondeurs, les
hoplites ouvrent la marche…les balises,
les provisions suivent l’arrière
garde…pour la Gaule c’est le jour
décisif… une horrible boucherie et
Magnence défait s’enfuit à Lyon et se
donne la mort… »
Les
fouilles de 1800 à 1805
Félix Bonnaire, premier préfet des
Hautes Alpes, demande la réalisation
d’un sondage à Joachim Janson, ingénieur
ordinaire des Ponts et Chaussée à Gap.
Le 11 octobre 1800, celui-ci met à jour
une pièce rectangulaire, en réalise le
plan et commente ainsi sa découverte : “
Le lieu de sondage est vers le milieu de
la plaine, un peu au-dessous et au midi
du village. L'angle du mur a été trouvé
à 20 cm de profondeur. A 5cm au-dessous
du mur, présence d'un pavé en mosaïque.
Cette pièce rectangulaire est liée à
d'autres murs non fouillés.
Les murs m à u et l à d = 10.8m
Les murs m à s et u à a = 6.5m
Ils sont en moellons taillés et posés en
appareils réguliers. ”
Mais ce relevé n’est pas situé par
rapport au village, nous ne savons pas
où fut réalisé ce sondage.
En 1802, un nouveau et jeune préfet est
nommé, le baron Jean-Charles François
Ladoucette. Amateur d'antiquités, il
s'intéresse très vite au site de Mons
Seleucus, et les habitants lui
facilitent la tâche en l'appelant au
secours après une mauvaise récolte : il
leur propose un travail d’excavation à
la pelle et à la pioche, pour un salaire
de 1F50 par jour.
Ladoucette obtient un crédit de 500
francs du gouvernement, auquel il
rajoute 6000 de ses propres deniers. Les
fouilles se déroulent sur deux mois, de
décembre 1804 à février 1805 avec 83
ouvriers.
La direction du chantier est confiée à M
Duvivier, Inspecteur des Contributions
Directes, sous la surveillance du
Vicomte Louis Héricart de Thury,
ingénieur des mines.
Les sondages mettent à jour des
structures et un important matériel,
inscriptions lapidaires, sculptures en
marbre et en bronze, monnaies, objets
métalliques, céramiques, objets en
verre. La plupart de ces objets ont été
trouvés dans un quartier d'habitation de
94 x 122 mètres, et un mithraeum (autel
à Mithra) a été découvert dans une pièce
de cette villa. L'autre grand édifice
repéré a été interprété comme une usine,
mais devait être plus probablement un
établissement thermal.
JCF Ladoucette en avril 1805, écrit à
l’Impératrice Joséphine pour qu’elle
invite le gouvernement à subventionner
de nouvelles fouilles, et qu’elle
intervienne auprès de l’Empereur pour
qu’il interdise aux propriétaires de
s'emparer des objets d’antiquité. Mais à
cette époque l’Impératrice a bien
d’autres soucis en tête…
La plus grande partie
des objets est vendue par les fouilleurs
à des collectionneurs ou des
antiquaires,
Le Préfet Ladoucette, amateur d’objets
d’art, se constitue une collection
personnelle, et tente de créer un musée
d’archéologie à Gap (celui-ci ne verra
le jour que cent ans plus tard). Des
objets, en particulier les inscriptions,
sont entreposés dans les jardins de la
Préfecture afin de constituer la future
collection du musée, mais ils
disparaîtront au fil des ans, comme le
mithraeum, qui disparaît entre 1820 et
1830.
Les autres objets, considérés comme les
plus remarquables, sont envoyés par
Aubin Louis Millin, Premier Conservateur
du Cabinet des Bronzes et Antiques de la
Bibliothèque Nationale, au Cabinet de la
Bibliothèque Impériale. La provenance
n’ayant semble t-il pas été indiquée
lors de l’arrivée des objets à Paris,
ceux-ci ne sont plus identifiables
aujourd’hui.
Une liste non exhaustive des objets a
été dressée par A.-L. Millin (reprise
par Ch. Romieu dans sa publication de
1892, Trouvailles faites à La
Bâtie-Montsaléon depuis le commencement
du siècle) : “ (…) des lampes
sépulcrales, avec le nom des fabricants,
un beau candélabre en bronze, des vases
en bronze, un strigile en bronze et un
en fer, un encensoir, un turibulum, un
priape en bronze, un squelette en
bronze, un manche de couteau, des
instruments d’agriculture, de ménage, de
fonderie et de sacrifice, en fer ou en
bronze, des vases et des coupes de terre
portant des inscriptions et des ex-voto,
écrits par les romains, sur ces vases,
pendant leur repas. ”
Quelques uns de ces objets ont été
dessinés par Joachim Janson, ; ces
aquarelles sont conservées aux Archives
Départementales des Hautes-Alpes et à la
Bibliothèque de l’Institut de France.
Les
fouilles de 1836 et 1837
le Dr Mas, un érudit local, reçoit 1500
francs de crédit du Préfet Mourgue pour
mener deux opérations archéologiques, en
novembre 1836 et 1837.
A nouveau, en 1836, de multiples
structures sont découvertes, ainsi que
de nombreux objets. Le docteur Mas
décrit ainsi ce qui est découvert :
“ On découvre de nombreuses
constructions en zigzag dont quelques
unes dallées en schiste bleu. Plusieurs
petits bâtiments de 2m², souterrains,
isolés, à ouverture unique et
supérieure.
Ces bâtiments étaient le long du chemin
en tête de Lachau et venant de l'église.
On y découvrit encore des fours de
potiers et de nombreux vases. Le
mobilier archéologique est abondant :
inscriptions, objets en bronze (aile
d'oiseau, fibules, une statuette), des
monnaies, plusieurs intailles, des
amphores, etc.
Ce que nous savons de ce mobilier nous
vient des échanges de courriers entre le
préfet Scipion Mourgues, le baron
Ladoucette, le ministre de l'Intérieur
et les responsables des fouilles.
Le 27 décembre 1836, du préfet Mourgues
au baron Ladoucette :
“ (...) avec l'emploi de 5 à 600 francs
seulement, nous avons obtenu pus de 200
monnaies et une infinité d'autres objets
que j'envoie à Monsieur le ministre de
l'Intérieur dans une caisse (...) ”
Le Préfet Mourgue envoie dans une
caisse, en décembre 1836, une multitude
d’objets au ministre de l’Intérieur, le
Comte A.-E.-P. de Gasparin. Il a établi
une liste écrite, dans un de ses
courriers au Ministre : “ 198 monnaies
en bronze et 5 en argent, des statuettes
ou parties de statuettes en bronze, des
outils métalliques, des céramiques
(lampes, tessons), des morceaux
d’amphores, des fragments d’os et de
dents, un fragment de marbre et une
multitude de ferrures, clous, etc. ”.
Il n’y a plus aucune trace de ces objets
après leur départ de La
Bâtie-Montsaléon.
Dans la même lettre, le préfet décrit un
pressoir, une pièce assez grande
contenant 6 grandes amphores coniques en
maçonnerie pouvant contenir plusieurs
hectolitres de liquide.
Les fouilles de 1837 apportent encore
leur lot de découvertes : des monnaies,
des outils, de la céramique, des
inscriptions sont découvertes.
Le 6 décembre 1837, des responsables des
fouilles, J. Bachelard et Mas,
commissaires, et Tourniaire, maire, au
préfet des Hautes-Alpes :
“ Le 20 novembre, ces fouilles ont
commencé. Le premier fossé ouvert dans
le champ de Laurent Lhabit, d'un mètre
de large sur 40 de long n'a rien produit
: la terre était toute végétale. Sur le
milieu, un trou d'un mètre de diamètre
était rempli de terre noire, brûlée et
mêlée avec quelques ossements ; à 2
pieds de profondeurs, le gravier pur a
paru.
Les autres fossés ouverts dans les
champs de Bachelard ont montré, à un
pied de profondeur, des murailles
grossièrement construites. Dans un
second fossé on a trouvé des glacis,
composés avec de la chaux, du sable et
des briques pilées. La journée du 21 a
donné 31 pièces de monnaie en bronze. Le
22, en creusant d'autres fossés, on a
trouvé un cippe renversé, de 17 pouces
d'élévation, de 12 pouces de large. La
seule inscription est Diis Manibus. Le
23, on a trouvé une pioche, une hache et
un marteau en forme d'arc ; le tout en
fer très oxydé. Le 24, on a trouvé des
lampes en terre cuite, une fibule, des
clous en fer. Le 25, la journée n'a
produit que des tas de briques brisées
et une pièce en argent phocéenne, de la
colonie de Marseille. Le 28, on a
découvert un autel votif, d'un mètre de
haut, avec une belle inscrioption VICT.
AVG. DD. VICTOR VITALIS F.L.M.
Le 29, on a trouvé des murailles près du
temple, de 3 mètres de distance,
paraissant former des rues ou des murs
de circonvallation ; n'ayant rien
produit dans l'enceinte, nous ne les
avons pas fait suivre. La journée du 30
n'a produit que des monnaies.
Le 1er décembre, on a trouvé une aile de
bronze, qui pouvait appartenir à une
aigle légionnaire. (...)
Le 2, on a trouvé des pièces et un bras
de statue en bronze tenant une tortue
dans sa main. Il existe un mur de plus
de 200 mètres. La face des pierres unie.
Le ciment est fort dur. Ce mur sert de
base à d'autres murs de construction
plus récente. Le nombre des médailles
passe 300.
Nous devons nous borner à suivre les
fossés que l'on a déjà faits.
Nous avons reconnu que le champ situé au
quartier de la Catalane, appartenant à
M. Tour, vicaire, était celui où l'on
avait trouvé le plus. C'est un intérieur
faisant partie du bâtiment, où l'on
avait trouvé, l'an passé, 14 amphores
(...) ”
Ces objets vont être pour l’essentiel
répartis dans des collections
particulières (dont celle du docteur
Mas), puis éparpillés.
Les découvertes
fortuites du XIXe siècle
Au fil des ans, les découvertes
fortuites se multiplient
- 1850 à 1855 : M. A. Fortune trouve
dans son champ des Campanes des
médailles, flèches, urne, céramique, 4
petites statues, un lion en pierre de la
taille d'un chien, des têtes de femmes
de pierre.
- 1859 : M. Pierre Vial trouve à Buzès
et vend à l'horloger de Serres, M.
Court, un vase en bronze pyramidal, une
plaque, un buste et une lampe en bronze
à col de cygne, une lampe sphérique en
verre, une chaîne en or, une lampe en
terre et des fragments d'une autre
lampe, un couteau à manche d'argent, une
grosse épingle. Cette collection a
disparu.
- 1854 à 1857 : pendant la construction
du canal, des tombes sont mises à jour
près de l'église, près d'un mur et
d'un oratoire enfouis à 2 mètres de
profondeur environ. Deux autres
sépultures sont trouvées près du canal à
Champuri, et des urnes et du matériel
funéraire au lieu-dit le Clot des
Paillards.
Les
fouilles de 1972
Avant la construction d'un garage dans
la résidence secondaire de Mr Jourdanne
(au quartier Les Granges), une fouille
préventive est réalisée par Michel
Colardelle à la demande de la Direction
des Antiquités de PACA. Elle constate
l'existence d'un habitat du milieu du
Ier siècle av. J.-C. mais ne peut aller
plus loin dans un laps de temps trop
court.
Photographies
aériennes 1991 - 2000
"La
situation évolua de manière
décisive en 1990 quand L.
Monguilan réalisa des photographies
aériennes qui permirent de
localiser d'importantes structures
en deux points de la
plaine de Lachau (Monguilan 1990 ;
Ganet 1995, p. 66-67, fig. 26 et
28). Il s’agissait des vestiges
figurant sur les plans de J.A.
Janson dont l’étendue et
l’organisation purent être précisées.
En 1994, R. Chemin effectua une
prospection inventaire du site
(Chemin 1994). De nouvelles
photographies prises en 1999 par
C. Hussy du Service Régional de
l'Archéologie et en
2000 par M. Huici, un habitant du
village, confirmèrent ces
découvertes. Des clichés, réalisés
dans d'excellentes conditions de
lisibilité, révélèrent l’existence
de structures orthogonales
en plusieurs endroits de la
plaine" (Philippe Leveau)
Mission Valorisation
du patrimoine archéologique (1999 -
2001)
Mission mise en place en juillet 1999
dans le cadre du programme européen de
développement rural Leader II, par la
commune de La Bâtie Montasaléon, pour
une durée de deux ans, avec un chargé de
mission : Christophe Barbier.
Il s'agissait de compiler les documents
et divers dépôts d'objets en musée à la
suite des fouilles de 1805, 1836 et
1837, afin de mieux connaître l'intérêt
scientifique du site archéologique et
son potentiel en terme de valorisation
culturelle et touristique.
La mission avait trois objectifs.
Connaissance scientifique de
l'archéologie protohistorique et
antique, deux périodes mal connues dans
le Buëch et la Durance hors les derniers
travaux érudits du XIXe siècle. Quelques
opérations de sauvetage ont été menées
entre 1958 et 1976 sur les habitats
protohistoriques de Chabestan et
Sainte-Colombe, sur la préhistoire à
Aspres-sur-Buëch et Montmorin par
exemple. D'autres fouilles, réalisées
lors de l'avancée de l'A51 entre
Sisteron et La Saulce, et le site
antique de Saint-Ariès complètent les
connaissances à l'orée de la mission,
mais sont statistiquement insuffisantes
pour aller au-delà de simples
hypothèses. La mission devait donc
contribuer à mieux connaître le site de
La Bâtie-Montsaléon ainsi que les autres
sites protohistoriques et antiques dans
la vallée. Ont été étudiés :
- Etat des
connaissances historiques en 1999
- Premières
découvertes fortuites
- Les fouilles de 1800
à 1805
- Les fouilles de 1836
et 1837
- Les découvertes
fortuites du XIXe siècle
- Les fouilles de 1972
- Les lieux de
conservation
- Récapitulatif des
collections par lieux de dépôt
Création d'un projet pédagogique,
supposé sensibiliser le public à
l’archéologie, notamment à travers les
enseignants et l'Inspection Académique.
Projet de valorisation touristique,
donnant au patrimoine archéologique la
possibilité de devenir un élément du
développement économique de la vallée.
La Bâtie-Montsaléon - Etat des lieux
Le territoire communal s'étend sur 1508
hectares
La commune comptait 115 habitants au XVe
siècle, 375 au XVIIIe, 296 au XIXe, et
146 habitants au recensement de 1999.
Une population vieillissante, une
agriculture devenue minoritaire mais
possédant un poids politique encore
fort, des arrivées de retraités et de
néo-ruraux en accroissement constant.
Économiquement, les possibilités
d'emploi sont très limitées.
L'agriculture est en déclin, la valeur
foncière des terres agricoles diminue,
le tourisme manque d'éléments forts
d'attractivité et de volonté de mise en
valeur par rapport au nord du
département. Une entreprise de dragage
est exploitée depuis de nombreuses
années, l'aérodrome représente un
secteur attractif en expansion et les
nouvelles technologies permettent
l'implantation de sociétés de service
libérales.
La
diffusion des connaissances auprès du
public
- L’exposition
archéologique de l’été 2000

Cette exposition, première du genre dans
le Sud du département, s’est tenue à la
Bâtie Montsaléon, du 1er juillet au 15
septembre 2000. Elle a été préparée en
collaboration avec le Service régional
de l’Archéologie PACA et l’Université de
Provence. Le Musée départemental a prêté
37 objets dont une grande partie
provient des réserves. L’exposition a
connu un réel succès avec 1500 visiteurs
en deux mois et demi.
L’exposition était divisée en 5 grandes
parties :
Première partie : La Bâtie Montsaléon à
l’aube d’un nouveau siècle présente la
commune actuellement
Deuxième partie :
- Les grandes
campagnes de fouilles du XIXème siècle
décrivant les fouilles de 1805, 1836 et
1837
- Les découvertes
fortuites du XVIIIème siècle
- La première fouille
organisée, décrivant le sondage
archéologique de 1800
- Fouilles et
découvertes fortuites au XXème siècle,
et en particulier les fouilles de 1972
et les découvertes fortuites réalisées
en 1996.
Troisième partie : La vie quotidienne à
travers quelques objets
Quatrième partie : Archéologie et
restauration
Cinquième partie : L’avenir du site
archéologique
- Les tables
d’interprétation
Installées sur la place du village en
septembre 2000, deux tables présentent
au promeneur l'agglomération antique et
les cultes religieux qui y étaient
pratiqués.

Table 1 : Mons Seleucus, une
agglomération des Alpes du Sud
Elle possède 4 éléments graphiques :
- La Table de Peutinger.
- La carte archéologique de la commune
réalisée en 2000, situant les sites
connus par la prospection aérienne, les
informations orales et écrites.
- La photographie aérienne prise en
1990, montrant un portique entouré d'une
construction centrale.
- Le relevé coté d'un quartier
d’habitation, réalisé par Janson en
1805, lors des fouilles Ladoucette.
Table 2 : Les cultes à La
Bâtie-Montsaléon
- Elle explique la présence de cultes
orientaux dédiés à Mithra et Isis, dont
les témoignages ont été découverts au
19e siècle sur le site.
- Elle décrit le culte impérial en
présentant un autel dédié à la Victoire
Auguste, autel aujourd'hui conservé au
Musée départemental des Hautes-Alpes.
Ces tables ont été installées pour
compléter l’exposition estivale
provisoire de l'année 2000. Leur
présence permanente permet de maintenir
une présentation des richesses
culturelles et du passé de la commune à
tout passant.
- La fête
gallo-romaine de juillet 2000
 La semaine de
fête gallo-romaine a eu lieu à La Bâtie
Montsaléon du 1er au 8 juillet 2000.
Elle est organisée par la Compagnie de
théâtre “ Pile ou Versa ”, en
collaboration avec la commune et la
mission Leader II. La semaine de
fête gallo-romaine a eu lieu à La Bâtie
Montsaléon du 1er au 8 juillet 2000.
Elle est organisée par la Compagnie de
théâtre “ Pile ou Versa ”, en
collaboration avec la commune et la
mission Leader II.
Cette semaine festive autour de la
présence du site antique a rassemblé
1500 personnes.
Des spectacles de théâtre, musique et
conte ont eu lieu chaque soir de la
semaine. La soirée du samedi 8 juillet
clôture l’événement avec un grand
spectacle final, reconstitution
burlesque de la bataille du 11 août 353
opposant Magnence aux généraux de
Constance.
Le retentissement de la fête a été
localement important. Elle a apporté à
la commune une image nouvelle et
dynamique, et l’a fait connaître bien
au-delà de la vallée du Buëch.

Dans le cadre des
animations de l'été 2000, ces repas ont
été mis en place par Mr et Mme Giroud,
propriétaires de l'auberge “ La Jument
Noire ” à La Bâtie-Montsaléon.
En voici le menu type, étudié d'après
des recettes d'Apicius, relevées dans
l'ouvrage sur la cuisine romaine de
Mesdames Blanc et Nercessian (1995).
Herbae rusticae - Herbe des champs
Moretum - Entrée au fromage de chèvre
Pullum Frontonianum - Poulet à la
Fronton
Minutal Matianum - Minutal à la Matius
Patina de Piris - Patina de poire
Le projet pédagogique “
Archéologie et paysage ” a été conçu
pour les écoles primaires en
collaboration avec Mr et Mme Vargoz,
propriétaires du gîte de groupe “ Les
Chariots du Buëch ”, installé à La Bâtie
Montsaléon.
Plusieurs intervenants participent à ce
projet et permettent d’aborder la
formation des paysages, le site de La
Bâtie Montsaléon, et la fabrication de
céramiques antiques.
Les classes découvertes sont accueillies
aux “ Chariots du Buëch ” avec :
- Un
géographe-interprète qui s’occupe de la
présentation géographique et
archéologique du paysage avec des
ateliers diaporamas, un atelier de
fouilles en bacs à sable
 , un atelier maquette
, et des visites ludiques sur le
terrain. , un atelier maquette
, et des visites ludiques sur le
terrain.
- Une céramiste qui
travaille avec les enfants sur un projet
de fabrication de sigillées.
Conclusions de la mission leader II
Au fur et à mesure
des travaux du chargé de mission,
présentés au comité de pilotage, présidé
par le maire de l’époque, il a semblé
incontournable d’aller vers un projet
global culturel et touristique après
2001.
Ce projet pouvait contenir :
- Un musée de site
gallo romain pour le sud du département
qui serait implanté à La Bâtie
Montsaléon, site le plus important de
cette époque.
- Le bâtiment aurait
accueilli aussi un lieu pédagogique et
de recherche avec un petit accueil-bar
et une bibliothèque archéologique.
- Des sondages étaient
envisagés et peut-être même des
fouilles.
- Des relais
thématiques (voir plus haut)
A la suite de cette prise de conscience
de l’importance du site gallo romain de
Mons Seleucus et au vu des conclusions
des divers comités de pilotage, la
région Provence Alpes Côte d’Azur a
inscrit la plaine de Lachaud sur la
liste des grands sites antiques de la
région (Mons Seleucus étant le seul site
répertorié sur les Hautes Alpes). De ce
fait la commune, après 2001, pouvait
bénéficier d’un financement au titre du
contrat de plan État - Région.
En 2001, une nouvelle municipalité
arrête la mission, et géle toute forme
d'aide que le Département, la Région, et
l'Etat étaient prêts à accorder à la
commune pour le site archéologique
(musée de site, bibliothèque
archéologique, lieu pour accueillir des
chercheurs, fouilles...)
La
Narbonnaise
En 2002, un article est paru dans
la revue de la Gaule
Narbonnaise... “ La
Bâtie-Montsaléon, Mons Seleucus, vicus
et sanctuaire gallo-romain dans le
Haut-Buëch (Hautes Alpes) ” , d'après
Philippe Leveau, Maxence Segard,
Christophe Barbier, Guy Bertucchi,
Bernard Simon
"L'examen des données archéologiques et
épigraphiques relatives au site de la
Bâtie-Montsaléon, Mons Seleucus, dans la
vallée du Buëch, conduit à en proposer
une interprétation nouvelle. Il s'agit
d'un vicus auquel est associé un
sanctaire contemporain de caractère
indigène. Connu surtout en Aquitaine, ce
type d'agglomération paraît bien
représenté en Gaule Narbonnaise."
La reprise des travaux archéologiques à
la fin du XXe siècle
Dans le cadre d’une mission de
valorisation du patrimoine archéologique
mise en place à l’initiative de la
commune et largement financée par un
programme européen, Christophe Barbier a
travaillé sur le site de Mons Seleucus
de 1999 à juin 2001. Il a rassemblé les
données anciennes éparses, les a
enrichies des découvertes fortuites
récentes, et en a tiré un plan général
restituant une partie de l’agglomération
romaine.
Bernard Simon et Maxence Segard ont
ensuite intégré ces données sur le fond
cadastral et un bilan archéologique a
été proposé, confrontant les données
anciennes et les acquis récents. Les
résultats de cette étude ont été publiés
dans La revue archéologique “ La
Narbonnaise ”, au long d’un article
titré et dont nous avons tiré le
présent résumé.
Les vestiges et leur réinterprétation
Les vestiges dégagés ou connus se
situent sur la plaine agricole de
Lachau, de part et d’autre du chemin du
Brieu. Ils ont été identifiés en 4
secteurs.
SECTEUR 1 : LE VICUS
Héricart de Thury y a décrit une grande
place bordée d’un grand édifice, et un
quartier inséré dans une enceinte aussi
grande que la domus du secteur 2. On y a
découvert de nombreux objets, comme un
petit aigle en bronze, des lampes et un
petit autel. Le bâtiment était construit
en grès et briques, à l’inverse des
autres édifices parés en moellons de
calcaire. Plusieurs cuves ont été
deécrites dans le même secteur, ainsi
que des outils de métallurgiste.
L’ensemble laisse supposer des “
installations artisanales liées à la
production de céramique et à la
métallurgie ”.
Il est certain par contre que des
thermes ont existé dans le même secteur.
Y ont été décrits une plate-forme
maçonnée surmontée d’un grand bassin
semi-circulaire entouré de réseaux de
canalisations. L’installation thermale
figure sur le plan de Janson, qui
précise qu’y ont été trouvé des charbons
et du métal.
De nombreux espaces d’habitation ont été
découverts autour des ateliers et des
thermes, dont on ne sait pas grand chose
sinon que ces “ maisons ” étaient
soigneusement bâties et richement
décorées (enduits, marbre, porphyre).
C’est dans l’une d’elles qu’on a trouvé
le mithraeum et son bas-relief en marbre
représentant le dieu Mithra (voir page
4). Un système d’adduction d’eau et de
canalisations en terre cuite et en plomb
reliait les habitations.
Les analyses des photographies aériennes
laissent “penser qu’on est en présence
d’îlots urbains, organisés autour de
rues et d’espaces ouverts (cours,
places, jardins)”.
SECTEUR 2 : LA DOMUS
C’est le secteur le mieux connu depuis
les premières fouilles. On y observe un
ensemble de structures quadrangulaires
orientées NE/SO et couvrant un espace de
50mx40m . On y reconnaît le plan d’une
domus autour d’une cour à portiques et
d’un atrium encadrés de pièces de
tailles différentes. Au sud-ouest, une
cour ou jardin de 18mX24m au moins. Au
nord-ouest et sud-ouest, une cour bordée
de deux couloirs allongés et d’une pièce
de 6mx24m, qui assure la transition avec
un ensemble de pièces plus petites
organisées autour d’un atrium carré de
12,5m de côté.
Sur les photographies aériennes,
plusieurs pièces apparaissent à environ
40m de la domus à l’ouest, à la limite
théorique du plan de Janson. Isabelle
Béraud y voit des dépendances de la
domus, mais certaines pièces très
richement décorées les désigneraient
plutôt comme pièces d’habitation. Les
espaces les plus grands “ ont pu être
des cours ou des jardins. Par hypothèse,
on peut penser que les pièces situées en
façade étaient des boutiques tandis que
des ateliers ou des pièces de stockage
se trouvaient à l’arrière. ”
SECTEUR 3 : LES ABORDS DU VICUS
Au nord-est de la mairie actuelle, un
bâtiment carré divisé en compartiments a
été décrit par fouilleurs de 1836. Des
dolia (jarres) d’1m60 de hauteur y
étaient enterrées dans une dalle
maçonnée, et reliées par des gouttières
creusées dans le sol. On y a vu un chais
avec peut-être un pressoir dans la salle
centrale.
Les photographies aériennes et des
sondages préventifs effectués en 2000
confirment la présence de structures
antiques mais ne permettent pas d’en
savoir plus sur leur caractère.
Dans le même secteur, la nécropole donne
la limite de l’habitat de ce côté du
vicus. On y suppose une autre domus à
atrium et un quartier de type urbain
structuré en quartiers, avec un système
d’adduction d’eau et un bâtiment
thermal. Les archéologues du XIXe s.
parlent d’une place au nord-est de cette
domus avec des fragments de statues
monumentales.
SECTEUR 4 : LE SANCTUAIRE
L’identification d’un sanctuaire est
l’apport principal de la synthèse
réalisée en 2001.
Au nord-ouest du secteur 2, d’autres
vestiges non urbains avaient été
remarqués par Ladoucette qui parlait
d’un temple, sans autres précisions. Les
prospections aériennes et géophysiques
ont repéré un ensemble quadrangulaire de
50mx44m, exactement orienté comme la
domus. Il se compose de deux structures
superposées, la plus vaste constituée de
deux rectangles autour d’un vaste espace
central et avec une saillie en façade, “
peut-être un porche ”. La seconde
structure s’allonge dans l’axe du “
porche ”. D’autres murs et une vaste
fosse ont également été identifiés dans
ce secteur.
Le nombre remarquable d’inscriptions
avait déjà fait supposer que Mons
Seleucus était un important centre
religieux. Il semble confirmé
aujourd’hui que l’ensemble de
l’agglomération reliée à une enceinte
cultuelle en fasse un vicus.
“ Les divinités attestées à La Bâtie
sont Isis, Mithra, et sans doute Jupiter
et la Victoire Auguste en relation avec
le culte impérial ”.
Conclusion
Mons Seleucus était donc “ une
agglomération de plaine que ne
définissait aucun rempart mais où une
présence aristocratique était
manifeste". La domus qui occupe le
centre de l’habitat est surprenante par
sa dimension (plus de 3500m²) et la
qualité de sa construction. ”
On n’a pratiquement rien trouvé sur le
site de plus ancien que la fin de
l’époque de La Tène, qui correspond en
fait au début de l‘époque romaine. Les
conclusions de la synthèse insistent
donc sur son caractère gallo-romain et
suggèrent de chercher des comparaisons
avec un même type de site plus
particulièrement connu en Aquitaine,
études qui pourraient réorienter les
spécificités prêtées à l’espace gaulois.
Prospections
géophysiques
2001 :
la prospection engagée par le Service
Régional de l’Archéologie en convention
avec le Conseil Général, et à la demande
de la municipalité a permis d’obtenir un
plan assez précis d’un bâtiment
d’environ 55m x 45m, visible quelle que
soit la profondeur d’investigation, 1m
ou 2m. "Son plan se présente comme un
emboîtement de quadrilatères dont
certains se recoupent." Il a été mis en
évidence la combinaison d'un centre
linéaire conducteur et de deux côtés
résistants. Quel qu'ait été leur rôle
originel, et même s'il s'agit de
plusieurs étapes de construction,
l'ensemble s'inscrit dans une continuité
architecturale.
Il a été également cartographié une
forme angulaire, sans doute une partie
d'habitation, proche d'une forme en
ellipse, qui pourrait être un bassin
avec un fossé le reliant à l'habitation.
Au centre du relevé, les prospections
présentent "une longue ligne résistante
qui semble correspondre à un ancien
chemin. Malheureusement, il est
difficile de le relier aux bâtiments
connus." Mais des anomalies linéaires
pourraient en être les ramifications et
impliquent l'existence d'autres
structures entre les bâtiments
répertoriés et des axes de communication
les reliant.
La conclusion de cette première
prospection contemporaine incitait à
l'étendre à des parcelles environnantes
afin d'obtenir une cartographie
d'ensemble de la richesse du site.
2003 :
la seconde prospection a donc concerné
les parcelles situées globalement au
nord de la parcelle prospectée en 2001.
Elle a mis en évidence un réseau de
drainage non répertorié sur les
cadastres, et diverses anomalies, déjà
observées à l'ouest, qui pourraient être
causées par des citernes emplies de
matériaux retenant l'humidité. Diverses
autres structures ont été détectées et
cartographiées.
Les deux rapports de la société Terra
Nova concluent donc en l’intérêt d’une
campagne de sondages archéologiques qui
pourraient seuls confirmer ou affiner
les hypothèses de travail émises par les
prospections géophysiques, et aider à la
compréhension des différentes
occupations du sol du village.
Fouilles 2005
Effectuées par Lucas Martin
(chargé de l’opération) et Stéphane
Fournier (technicien) de l’INRAP,
l’Institut national de recherches
archéologiques préventives.
 Résumé succinct
de leur rapport de fouilles : Résumé succinct
de leur rapport de fouilles :
Une demande de permis de
construire étant déposée pour la
réalisation d’une maison sur la parcelle
ZH 18 de la plaine de Lachaud, des
fouilles ont été effectuées pour voir
s’il y avait la présence de vestiges
anciens et confirmer la présence de la
cité. Cette parcelle n’était pas à
priori la plus riche (cf. prospection
aérienne et géophysique). La parcelle
est située en amont de la plaine de
Lachaud. Elle est ouverte à l’ouest sur
une zone bien dégagée.
La zone à sonder est située à
l’intérieur du périmètre de la ville,
mais dans un secteur où l’on possède peu
d’éléments d’information.
Huit sondages ont été faits (5 tranchées
parallèles dont les extrémités ont
parfois été prolongées pour dégager très
partiellement un plan de bâtiment)
Les constructions et les dépotoirs
dégagés :
La maison A : Les murs forment un espace
rectangulaire de 7,50 m sur 6 m. Les
murs continuent dans plusieurs
directions (cette pièce appartiendrait
peut-être à une maison plus vaste). Ils
sont liés au mortier et se présentent en
fondation ou sur une première assise
d’élévation selon une largeur de 0,50 à
0,55m.
La maison B : Elle comportait au minimum
trois espaces définis par les sondages 4
et 6. Le décapage du plan est trop
lacunaire pour en déduire des éléments
vraiment pertinents.
Les dépotoirs : Fouillés très
partiellement, ils ont donné le matériel
suivant :
Des formes de SSG complètes avec deux
marques de potiers, des clous, bronzes,
verres, tubulure et pillette
d’hypocauste, débris d’amphores,
céramiques, faunes, pierre oliaire ; des
monnaies de bronze du bas empire (IVeme
siècle) confortent la datation d’abandon
classiquement retenue.
La typologie du matériel n’est pas
entièrement cernée car certaines
céramiques communes sont des productions
locales méconnues faute de fouilles
fréquentes dans la zone alpine.
Toutefois leur forme emprunte au
répertoire gallo-romain classique et aux
sigillées sud gauloises.
L’extension des bâtiments antiques et
celle de niveaux d’occupation compris
entre le Ier et le IVème siècle, est
confirmée dans cette zone sur toute
l’étendue de la parcelle.
Fouilles
2006
Une fouille
réalisée par Maxence Segard et Éric
Conrad au lieu-dit le
Champ de l’Arène a confirmé l’existence
d'un quartier artisanal en marge de la
parcelle 1168, section B du cadastre
communal. Elle est attestée par la
présence de plusieurs dizaines de kilos
de culots de fer depuis les niveaux les
plus anciens jusqu'à l'abandon. En
périphérie nord, d'épaisses lentilles de
terre charbonneuse, de terre rubéfiée et
une concentration plus forte de culots
suggèrent la proximité immédiate
d’installations de transformation du
minerai de fer. Des lingots de plomb
avaient été trouvés dans une parcelle
proche (Segard et Conrad 2005).
Fouilles
2008
Fouilles
2010 voir page
actualités
haut
|
|
|
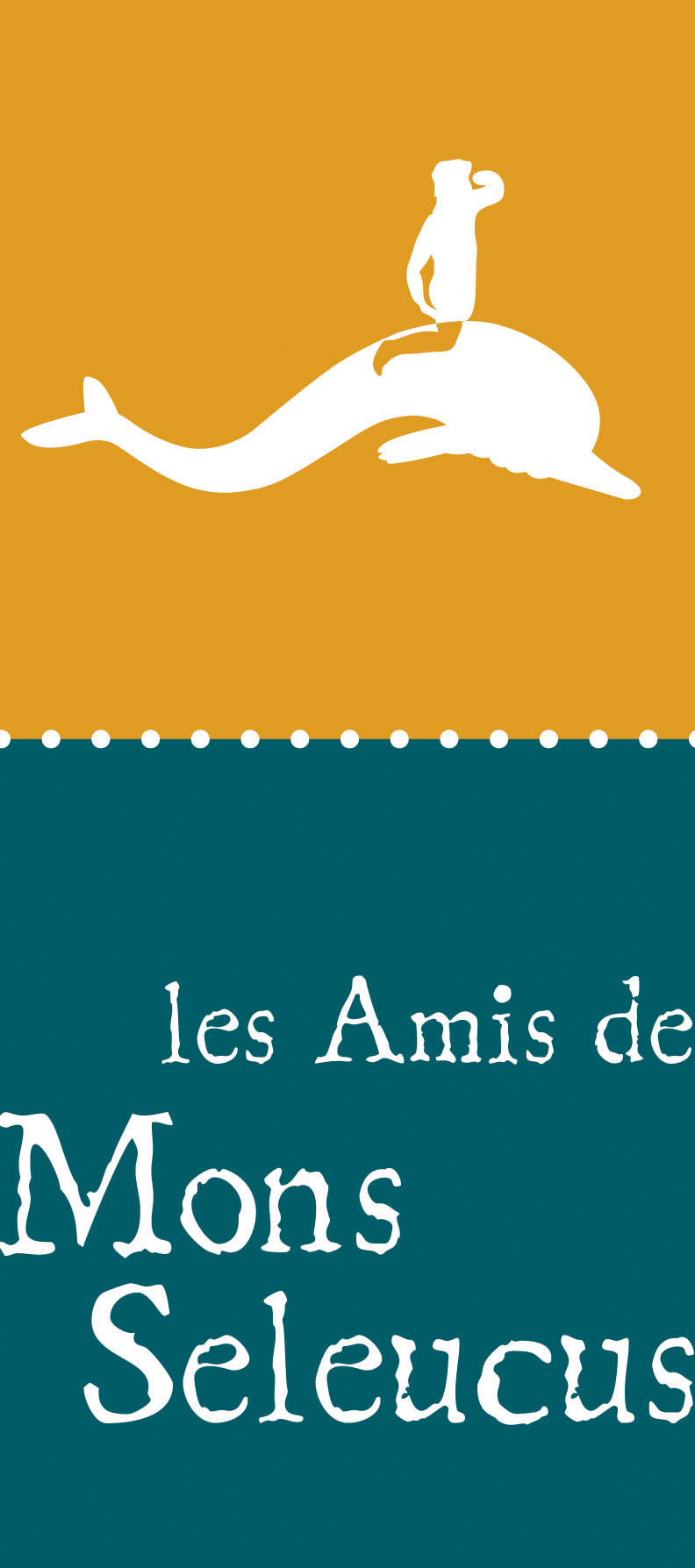
LES AMIS DE MONS SELEUCUS
05700 La Batie-Montsaléon
Tél :06 08 77 22 93
contact
|
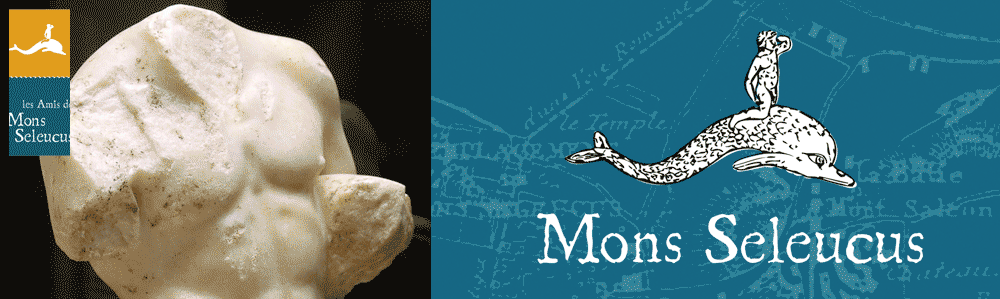








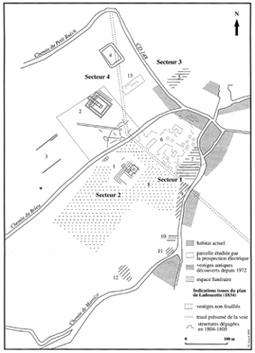


 La semaine de
fête gallo-romaine a eu lieu à La Bâtie
Montsaléon du 1er au 8 juillet 2000.
Elle est organisée par la Compagnie de
théâtre “ Pile ou Versa ”, en
collaboration avec la commune et la
mission Leader II.
La semaine de
fête gallo-romaine a eu lieu à La Bâtie
Montsaléon du 1er au 8 juillet 2000.
Elle est organisée par la Compagnie de
théâtre “ Pile ou Versa ”, en
collaboration avec la commune et la
mission Leader II.
 , un atelier maquette
, et des visites ludiques sur le
terrain.
, un atelier maquette
, et des visites ludiques sur le
terrain. Résumé succinct
de leur rapport de fouilles :
Résumé succinct
de leur rapport de fouilles :